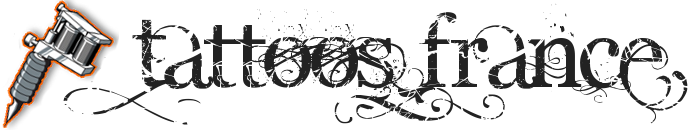Il semblerait qu’il y a environ 12 000 ans, en France et en Espagne, les hommes aient scarifié, percé et tatoué leur pénis de façon très courante.
De quels motifs ornaient-ils leur sexe? De points, de lignes, de triangles et de cercles.
« L’art phallique » constitue apparemment une catégorie officielle de l’art paléolithique, car c’est par cette jolie expression que certains chercheurs désignent le 21 octobre, dans la revue The Journal of Urology les dernières découvertes en matière de sculptures anthropomorphiques. En analysant les décorations qui ornent des pénis sculptés de l’âge des cavernes, Javier Angulo, chercheur à l’hôpital universitaire de Getafe (Espagne), et l’anthropologue Marcos Garcia-Diez ont découvert que nos ancêtres n’avaient pas attendu le développement de la culture gay SM pour infliger à leur organe toutes sortes de supplices… allant jusqu’à l’inciser ou le circoncir.
Angulo affirme qu’il s’agit là des premières traces répertoriées de modifications génitale. «A cette époque déjà, il ne s’agissait probablement que de s’approprier son identité, explique-t-il. Les cicatrices que les hommes se faisaient étaient une façon d’écrire leur histoire sur leur peau. C’était ornemental. C’était aussi une façon ritualisée de prendre sa place dans la société. A cette époque, comme de nos jours, l’essentiel des modifications corporelles se situaient dans les zones hautement symboliques que sont le visage et les parties génitales, c’est à dire tous les endroits du corps qui entourent les orifices.» Ces endroits-là sont les plus décorés, parce que sont les zones d’échange principales entre le dedans et le dehors.
Pour Angulo et ses collègues, nul doute que les pratiques des “primitifs modernes” datent des premiers temps de l’humanité: le plus ancien des phallus décoré d’incisions date de 30 000 ans en arrière. Il a été trouvé dans la grotte de Volgherd en Allemagne et son origine remonte à l’aurignacien. Mais c’est vraiment à l’époque magdalénienne que ce genre de pratique semble devenir courant. «Les décorations sont des lignes (70%), des plaques (26.7%), des points ou des trous (23.3%), parfois aussi des formes animales ou humaines (13.3%)».
Angulo note que les sculptures en question montrent systématiquement des organes en érection, comme si les hommes du paléolithique associaient à la puissance phallique l’acte d’inciser, perforer, couper ou entailler leur sexe. Il note aussi que ces décorations péniennes sont les mêmes que l’on retrouve sur les parois des grottes: motifs géométriques semblables à des graduations, encoches tracées à égales distance comme pour tenir le compte d’actes victorieux ou marquer le passage des lunes, formes ovales en damier, lignes superposées de triangles… Il est impossible de savoir précisément à quoi correspondaient ces ornements.
«L’amour sensuel et l’appétit sexuel sont inhérents à l’humanité, explique Angulo. Les pratiques érotiques de ces hommes devaient être les mêmes que les nôtres aujourd’hui». Garcia ajoute: «Le sexe, c’est de la culture. Pas simplement de la biologie. Il ne s’agit pas seulement de se reproduire. Le sexe, depuis des milliers d’année est une question de plaisir, de jeu, d’art et de rêve». Pour comprendre le sens de ces décorations péniennes primitives, les deux chercheurs se contentent donc de suggérer l’évidence: les points pareils à des trous et les stries à des lignes de force renvoient certainement à la vision d’un monde fait de portes qu’il faut pousser et de morts successives… Faut-il ici rappeler que le mot « sexe » vient du verbe latin secare, « couper »? En décorant leur pénis, nos ancêtres reproduisaient certainement cette coupure symbolique qui permet aux choses de se différencier – la lumière des ténèbres, le ciel de la terre, les mâles des femelles, le bébé de sa mère – afin de passer à l’étape supérieure de leur développement.
Pas d’altérité possible sans différenciation. Pas de désir, ni d’amour, sans altérité. Suivant cette logique simple qui impose, dans toutes les sociétés, une scission entre les hommes et les femmes, les mutilations sexuelles ont certainement été, dès le départ, une façon de s’approprier son sexe. «Chacun doit ensevelir en lui le vieux mythe de l’unité double pour assumer les limites et les responsabilités différentes et rigoureusement définies de son sexe», mâle ou femelle, explique -dans un livre d’éthnologie publié en 1977- Jacqueline Khayat, qui définit la mutilation génitale comme «le signe visible, la confirmation de l’appartenance à un groupe»: féminin, masculin… Point, ligne… Triangle, comme une pointe de flèche phallique ou comme un pubis fendu… Cercle, comme l’ovale d’une vulve ou comme le gland, auréolé de gloire, lorsqu’il se décalotte en libérant sa couronne… Venus du fond des âges, ces motifs géométriques répètent à la façon de formules magiques que rien ne peut naître ni évoluer sans que les forces mâles et femelles se coupent l’une de l’autre, se séparent, s’attirent puis se rejoignent. Le peintre Klimt, qui peignait soigneusement le corps nu de ses modèles, les recouvrait ensuite de tissus constellés de triangles et de cercles, à la façon de symboles protecteurs. Qu’est-ce qu’un corps, s’il n’est pas recouvert d’une couche de sens ? Qu’est-ce qu’un corps, s’il reste nu, privé de toute marque qui manifeste son appartenance au monde des signes et des mystères ?
Il reste cependant une énigme à élucider : les modifications génitales semblent n’avoir concerné, au paléolithique, que les hommes. Angulo et Garcia restent curieusement silencieux sur ce point. Jacqueline Khayat, elle, avance: «Les mutilations sexuelles masculines ont sans doute précédé celles qui furent infligées aux femmes». Pourquoi? On l’ignore. Etaient-elles différentes? Jacqueline Khayat avance que celles infligées aux femmes avaient essentiellement pour but de brider voire supprimer leur sexualité . Mais parmi celles infligées aux hommes, elle cite pourtant de nombreux cas de castration rituelle, totale ou partielle, et mentionne l’effet traumatisant de la circoncision. On ne sort pas forcément « grandi » d’un rituel d’initiation. Il y a donc une grande différence, quoiqu’on dise, entre les modifications corporelles rituelles et celles qui sont pratiquées de nos jours dans les studio de body piercing et de tatouage.
Source: Liberation